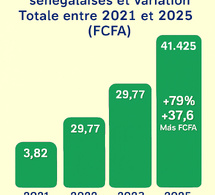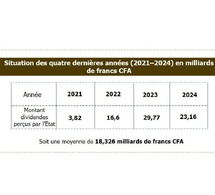|
Inscription à la newsletter
|
|
Tags (4) : actualite mines senegal afrique
Dividendes miniers au Sénégal : entre mobilisation record et opacité persistante
actualite mines senegal afrique,
dividendes minieres senegal,
energie mines afrique,
etat senegal,
gouvernance extractive,
itie senegal,
mines fiscalite,
mobilisation fiscale,
partenariats publics,
rapport annuel 2025 somisen,
redevabilite publique,
revenus secteur minier,
somisen sa,
souverainete economique,
transparence financiere,
variation dividendes
SOMISEN SA : entre ambitions stratégiques et défis opérationnels
actualite mines senegal afrique,
agenda national transformation,
chaine aurifere,
cobalt,
comptoir or,
controle,
cuivre,
delivrance titres,
dividendes,
lithium,
manganese,
materiaux construction,
mineraux strategiques,
phosphates,
plan strategique developpement 2025 2029,
production engrais,
raffinerie or,
reglementation,
societe mines senegal,
somisen,
souverainete miniere,
titres miniers,
transformation,
transformation locale,
transition energetique,
valorisation
News récentes
Tags
Facebook
Brèves
Derniers tweets
Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication

 🗞️ Actualités sectorielles
🗞️ Actualités sectorielles